Radioscopie d’un pays fragmenté : entre élites et peuple (Version longue)
Version longue.
Madagascar fête son indépendance depuis 65 ans, mais à y regarder de plus près, cette souveraineté ressemble souvent à une vitrine. Derrière le drapeau, l’hymne et le siège aux Nations Unies, les mécanismes hérités de la colonisation continuent de structurer la vie politique, l’économie, l’éducation et même le langage du pouvoir.
Ce document propose une radioscopie du fonctionnement du pays, loin des mythes officiels. Les faits présentés sont tirés du quotidien des Malgaches, de leur rapport aux institutions et des dépendances visibles ou invisibles qui encadrent leurs vies.
Car pour savoir où l’on va, encore faut-il savoir d’où l’on vient. Or, l’histoire de Madagascar est celle d’une indépendance inachevée, où les élites se forment encore en France, où les secteurs stratégiques sont dominés par des multinationales étrangères, et où la langue du droit n’est pas celle de la majorité.
Comprendre le contexte et l’origine des maux, c’est la seule voie pour envisager des solutions. C’est cette lecture sans détour que cet article propose : mettre à nu l’architecture de dépendance qui façonne la trajectoire de la Grande Île, et ouvrir la réflexion sur ce qu’il reste à construire pour transformer l’indépendance en réalité vécue.
Nationalité et trajectoires des présidents malgaches
- Andry Rajoelina (président actuel, élu en 2018 puis réélu en 2023) :
- Il a obtenu la nationalité française en 2014 avec sa famille, alors qu’il résidait en France après la crise de 2009.
- Sa naturalisation française procède d’un décret publié au Journal officiel en novembre 2014 (décret du 19/11/2014, JO du 21/11/2014). Ce point n’est pas une “confirmation” par le Conseil d’État : juridiquement, la naturalisation est un acte réglementaire du gouvernement, susceptible de recours devant le juge administratif mais non “validé” par lui par défaut.
- Lors de la présidentielle 2023, les recours de l’opposition n’ont pas porté sur la simple “double nationalité”, mais sur la perte alléguée de la nationalité malgache au titre de l’article 42 du Code de la nationalité (« Perd la nationalité malgache, le Malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère »). La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a, à différentes étapes, validé la liste des candidats et rejeté l’exception de nationalité dans ses décisions de proclamation. En clair : la contestation a bien visé la perte de nationalité, pas seulement la binationalité.
Cette situation reste inédite dans la période post-indépendance : non pas parce que des présidents n’auraient jamais été “français” (avant 1960, la nationalité française coloniale s’appliquait aux élites nées sous domination française, comme Tsiranana ou Ratsiraka, qui l’ont perdue en 1960), mais parce qu’un chef d’État post-1960 a volontairement acquis la nationalité de l’ancienne puissance coloniale et a ensuite exercé la magistrature suprême. Cela pose une question symbolique autant que juridique : à qui se rattache l’allégeance ultime, et que dit ce fait du rapport réel au principe de souveraineté ?
- Philippe Tsiranana (1960-1972), premier président :
- Études en France (École normale de Montpellier). Très lié aux réseaux politiques français (notamment à l’Union française).
- Son entourage politique et ses accords économiques étaient largement arrimés à Paris (cf. Accords de coopération franco-malgaches de 1960).
- Source : “Madagascar et la France : un pacte colonial ?”, Revue Politique Africaine, 1986.
- Albert Zafy (1993-1996) :
- Non français, mais formé à Montpellier (médecine). Exemple typique d’élites malgaches formées en France et imprégnées de références françaises dans leur gouvernance.
Signification symbolique
- La double nationalité du président actuel est une première historique en Afrique : un chef d’État en exercice ayant aussi la nationalité de l’ancienne puissance coloniale.
- Cela alimente le discours d’“indépendance fictive” : le représentant suprême de l’État malgache est également citoyen d’un autre pays, et pas n’importe lequel.
- Dans la perception populaire, cela se traduit par une méfiance : “peut-on être président malgache et français en même temps sans conflit d’intérêts ?”
Impact politique et diplomatique
- Sur le plan régional, lors de la présidence tournante de la SADC en 2025, cette situation a été relevée par plusieurs observateurs : un président français à la tête d’une organisation censée défendre les intérêts africains (cf. article “Madagascar et la présidence de la SADC – Prestige contre pauvreté[1]”, KB Diapason, sept. 2025).
- Sur le plan diplomatique, Paris bénéficie d’un accès privilégié au pouvoir, ce qui renforce l’idée d’une dépendance politique.
En clair
Le cas d’Andry Rajoelina, président malgache mais aussi citoyen français, incarne l’ambiguïté de l’indépendance. Plus qu’une anecdote, il révèle une architecture de dépendance où les élites politiques peuvent appartenir juridiquement, culturellement et symboliquement à deux espaces à la fois – Madagascar et la France – mais dans un rapport profondément inégalitaire.
- Constat : Plusieurs présidents malgaches sont nés en France ou ont la double nationalité (ex. le président actuel). Cela crée une ambiguïté symbolique : à la tête de l’État, on retrouve un dirigeant lié par le droit et la culture à l’ancienne puissance coloniale.
- Effet : Cela alimente l’idée que le pouvoir est arrimé à Paris, et que la souveraineté politique reste fragile.
Les secteurs clés sont contrôlés par des entreprises étrangères
Énergie
- Énergie. L’entreprise publique JIRAMA dépend structurellement de producteurs privés (IPP) et d’importations d’hydrocarbures. Sur le thermique, Jovena (groupe AXIAN) est adjudicataire fréquent des marchés de gasoil/fioul destinés aux centrales ; TotalEnergies, Vivo, Galana soumissionnent et remportent aussi des lots selon les années. Côté nouveaux projets, la filière hydroélectrique (ex. Volobe) agrège des capitaux et expertises étrangers. Le résultat est une vulnérabilité prix-volume qui se répercute sur les tarifs et sur la continuité de service. (Diapason, Comprendre la situation énergétique de Madagascar[2], 2025).
Mines et ressources naturelles
- Ambatovy (nickel et cobalt) : Projet de 8 milliards USD, le plus grand investissement étranger jamais réalisé à Madagascar.
- Propriétaires : Sherritt International (Canada), Sumitomo (Japon), Korea Resources Corp (Corée du Sud).
- Exportations : quasi-totalité destinée au marché international.
- Retombées fiscales : très faibles (régime d’exonérations, conventions minières).
- Source : Banque mondiale, Madagascar Economic Update 2023.
- QMM – Rio Tinto (ilmenite à Fort-Dauphin) :
- Multinationale anglo-australienne, avec participation minoritaire de l’État malgache (20 %).
- Critiques : pollutions, faibles redevances.
- Source : Friends of the Earth, Rapport 2022 ; ONG Andrew Lees Trust.
- Base Toliara (sables minéralisés) :
- Projet australien suspendu en 2019 pour contestations sociales.
- Revenus attendus massivement rapatriés hors du pays.
- Source : Rapport OCDE sur la gouvernance minière, 2023.
- Graphite : Nouvelles concessions dominées par des compagnies chinoises (ex. Tirupati Graphite).
Télécommunications
- Orange Madagascar : filiale à 100 % d’Orange France.
- Airtel Madagascar : filiale du groupe indien Bharti Airtel.
- Telma : officiellement détenue par le groupe mauricien Axian (Hassanein Hiridjee), partenaire de fonds étrangers.
- Conséquence : Les infrastructures stratégiques de télécoms (satellite, fibre optique, data centers) sont aux mains de capitaux extérieurs.
- Source : ARTEC (Autorité de régulation malgache des télécoms), rapport 2022.
Banques et finance
- BNI Madagascar est contrôlée par AXIAN (via IOFHL) avec un partenaire mauricien (IBL).
- BFV-Société Générale : filiale du groupe français Société Générale.
- BOA (Bank of Africa) : filiale de BMCE Bank of Africa (Maroc).
- Conséquence : La finance, qui irrigue toute l’économie, est sous contrôle d’intérêts étrangers, avec des taux d’intérêt décorrélés des réalités locales.
- Source : Banque centrale de Madagascar, Rapport annuel 2023.
Agro-industrie et ressources agricoles
- Vanille : dominée par des multinationales (Symrise – Allemagne, Firmenich – Suisse, McCormick – USA).
- Huile essentielle / Clou de girofle : filières captées par des traders indiens, chinois et européens.
- Source : Cartographie économique des communautés[3] (Diapason, 2025).
Synthèse
- Tous les secteurs stratégiques (énergie, mines, télécoms, finance, agro-industrie) sont contrôlés par des multinationales étrangères.
- L’État malgache y détient rarement plus de 20 % de participation, souvent symbolique.
- Les recettes fiscales sont limitées à cause des conventions d’investissement, exonérations et montages financiers (cf. Diapason, L’économie fantôme d’une nation spoliée[4]).
- Cela confirme que la souveraineté économique est inachevée : Madagascar produit pour l’extérieur, consomme peu localement, et dépend des décisions de sociétés étrangères.
-
- Conséquence : La rente nationale échappe en grande partie au budget public malgache. Comme dit dans L’iceberg inversé[5], la richesse existe mais elle est invisible aux Malgaches.
Formation des hauts fonctionnaires en France
Héritage colonial et dépendance éducative
- Après 1960, Madagascar a conservé la structure éducative héritée de la France.
- Les premières générations de hauts fonctionnaires (1960-1980) ont été formées en France, notamment à l’École nationale d’administration (ENA), à l’École normale supérieure (ENS) et dans les facultés de droit, économie et médecine de Paris, Lyon, Bordeaux et Montpellier.
- Cela a façonné une élite “francisée”, calquée sur le modèle français de gouvernance.
- Source : “L’éducation et la construction de l’État à Madagascar” (Roubaud & Razafindrakoto, IRD, 2018).
Formation actuelle des hauts fonctionnaires
- Selon les données de l’Ambassade de France à Madagascar (2022), plus de 3 500 étudiants malgaches sont inscrits chaque année dans des établissements français, ce qui fait de la France la première destination universitaire.
- Parmi eux, une majorité se dirige vers le droit, l’économie, la science politique, la médecine et l’ingénierie – filières qui nourrissent ensuite la haute fonction publique.
- Les grandes écoles françaises (ENA, Sciences Po, Polytechnique, Mines ParisTech, HEC) comptent régulièrement des profils malgaches qui reviennent ensuite occuper des postes stratégiques.
- Source : Campus France, Chiffres clés 2022.
Exemples concrets
- Plusieurs ministres récents sont passés par les universités françaises :
- Richard Randriamandrato (Finances) → Sciences Po Paris.
- Hajo Andrianainarivelo (Aménagement du territoire) → Études supérieures en droit en France.
- Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison (Économie) → Doctorat en économie en France.
- Le corps diplomatique et les directeurs des grandes régies publiques (douanes, impôts, banques publiques) sortent presque exclusivement de formations françaises.
L’enseignement supérieur local reste dépendant
- Les universités malgaches (Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Mahajanga, Toliara) appliquent un modèle académique calqué sur la France :
- Langue d’enseignement : le français, notamment en droit, médecine, économie, sciences politiques.
- Programmes : souvent alignés sur les maquettes françaises, avec dépendance aux manuels et références françaises.
- Conséquence : la recherche malgache est peu financée et rarement indépendante ; elle reste dominée par des coopérations avec la France (IRD, CNRS, AUF).
- Source : “Système universitaire et coopération francophone à Madagascar”, AUF, 2020.
Armée / unités combattantes
- Garde présidentielle – formation des instructeurs (fin mai 2025)
Gradés/instructeurs de l’unité d’élite entraînés par un détachement du 2e RPIMa (Forces armées de la zone sud de l’océan Indien – FAZSOI, La Réunion). Objectifs : tir, tactique, sécurité rapprochée, pédagogie d’instruction[6]. - 1er Bataillon parachutiste (BATPARA) – montée en puissance (mai–juin 2025)
Gradés (officiers/sous-officiers) encadrés par la section commando d’aide à l’engagement du 2e RPIMa : sauvetage au combat, combat en localité/zone ouverte, tir de précision[7].
Gendarmerie (force militaire intérieure)
- École supérieure de la gendarmerie nationale (ESGN, Moramanga) – appui pédagogique récurrent
Renforcement des formateurs et officiers supérieurs (conception de modules, ingénierie de formation) dans le cadre de la DCSD (Direction de la coopération de sécurité et de défense – MEAE). Sessions récurrentes 2019-2025 ; coopération officialisée et suivie par l’ambassade de France[8]. - Cadets de la gendarmerie – promotion 2024/2025
Parcours de 10 mois à l’ESGN ; cérémonies et communications officielles rappellent l’appui français (langue, pédagogie, équipements) via la DCSD/mission de défense. (Montre la continuité du soutien sur les promotions de cadets et les cadres encadrants[9].) - Français sur objectifs spécifiques (FOS) pour la gendarmerie – appui langue de service
Depuis 2012, ~1 200 élèves gendarmes/an suivent des cours FOS ; extension aux cadres (2019) et cadres supérieurs (2020) avec soutien du Service de sécurité intérieure de l’ambassade de France et de l’Alliance française de Moramanga. (La maîtrise de la langue conditionne l’accès aux stages tactiques/techniques[10]).
Police nationale (sécurité intérieure – hors « armée » mais pertinent pour le dispositif français)
- Formations conjointes ENSP (France) – ENIAP (Antsirabe) – mai 2025
Stage commun d’instructeurs (pédagogie, techniques d’intervention) : présence de formateurs français de l’ENSP auprès des cadres malgaches[11]. - Envois d’officiers en écoles françaises (2025-2026)
: un commissaire admis à l’ENSP Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et un officier à l’ENSOP Cannes-Écluse pour un an de cursus[12] (sélection 2025).
Ce qu’on peut affirmer solidement
- Il existe plusieurs filières actives où des gradés (officiers/sous-officiers) malgaches sont actuellement formés par des instructeurs français : 2e RPIMa (partenariat militaire opérationnel), Mission de défense/DCSD (gendarmerie, pédagogie, langues), et ENSP[13] (police/instruction).
Les listes nominatives des gradés en cours de formation ne sont pas publiées pour des raisons évidentes de sécurité opérationnelle. Les sources officielles communiquent surtout par unités, promotions et dispositifs (FAZSOI/2e RPIMa, DCSD, ENSP).
Conséquences sur la souveraineté
- La pensée d’État reste largement importée : modèles juridiques, fiscaux, administratifs inspirés du droit français.
- Reproduction des élites : ceux qui maîtrisent la langue et les codes français accèdent aux postes de pouvoir, accentuant la fracture avec la majorité malgachophone.
- Cela entretient la perception d’un État “sous tutelle intellectuelle” : l’expertise locale est peu valorisée, l’innovation institutionnelle bridée.
En résumé
La haute administration malgache est formée majoritairement en France, ce qui maintient une dépendance intellectuelle et culturelle. L’enseignement supérieur local, affaibli, n’a pas encore acquis la légitimité nécessaire pour former de manière autonome ses élites administratives. C’est l’un des piliers de l’“indépendance inachevée” : même si le drapeau est malgache, l’architecture de l’État fonctionne toujours selon les plans dessinés à Paris.
- Héritage colonial : Depuis 1960, l’ENA française, les universités parisiennes, Lyon, Bordeaux, Montpellier ont formé la majorité des élites administratives et politiques malgaches.
- Conséquence : Reproduction d’un modèle étatique calqué sur la France, sans adaptation profonde aux réalités malgaches. On forme pour gérer un État « miroir » de l’ancien colonisateur, non pour inventer un modèle autonome.
La langue officielle dans les hautes fonctions : le français
Statut juridique des langues
- Depuis la Constitution de 2010 (IVe République) : “Les langues officielles sont le malagasy et le français.” Le malagasy est la langue nationale[14].
- Entre 2007 et 2010 (révision constitutionnelle du 27 avril 2007) : l’anglais avait été ajouté aux langues officielles aux côtés du malagasy et du français ; il disparaît en 2010[15].
Administration centrale : bilingue en droit, français en pratique
- Les textes officiels (Constitution, lois, règlements) sont publiés en malagasy et français ; la version française demeure la référence pour la technique juridique et administrative au niveau central[16].
- En pratique, dès qu’il s’agit de documents techniques, les administrations centrales privilégient le français[17] (rédaction des notes, appels d’offres, manuels de procédures).
Justice et langage du droit
- La formation et la pratique du “français juridique” sont institutionnalisées (programmes officiels de maîtrise du français administratif/juridique pour magistrats et agents), ce qui entérine l’usage du français comme langue de travail dans la justice[18].
- Historiquement, l’architecture juridico-administrative héritée de la période coloniale a ancré la primauté du français dans les juridictions pour les populations “de statut civil français” ; cet héritage a laissé une forte empreinte dans la culture judiciaire[19].
Enseignement et production normative
- Le secondaire/supérieur utilisent massivement le français comme langue d’enseignement dans les filières juridiques, économiques, médicales et d’ingénierie ; ceci alimente ensuite l’usage du français dans l’administration et les corps techniques[20]. (Convergences OIF/AUF et littérature académique).
- L’emploi dominant du français administratif accroît un clivage sociolinguistique entre élites francophones et majorité malgachophone, relevé par les travaux en sociolinguistique[21].
Données de contexte utiles
- L’OIF rappelle le poids du français à Madagascar (pays membre de plein droit) et son usage institutionnel ; les rapports 2022 offrent les repères globaux sur les locuteurs et la dynamique francophone[22] (cadre dans lequel s’inscrit Madagascar).
- Les pages Constitute Project et la version PDF officielle de la Constitution confirment le binôme officiel Malagasy-Français depuis 2010[23].
Ce que cela implique concrètement
- Accès au droit et aux services publics : l’usage préférentiel du français dans les procédures techniques crée un biais d’accès pour les citoyens non francophones, malgré le bilinguisme de droit[24].
- Pouvoir symbolique et technicité : maîtriser le français technique reste un sésame pour les carrières d’État (justice, finances, marchés publics), prolongeant la dépendance culturelle et cognitive vis-à-vis des normes francophones.
- Fait : Le malagasy est la langue nationale, mais le français reste la langue de l’administration, du droit, des affaires, et des relations diplomatiques.
-
- Conséquence : Barrière entre élite francophone et population majoritairement malgachophone → fracture sociale et politique.
- Analyse Diapason : C’est une des clés de la spoliation invisible :
la gouvernance se fait dans une langue inaccessible à la majorité.
Ceci dit, il nous faut préciser quelques points concernant la langue malgache (malagasy).
Objection juste d’un lecteur : quel « malgache » ? Le malgache standard repose historiquement sur le dialecte merina (Antananarivo), alors que l’île compte de nombreux tenim-paritra (parlers régionaux). D’où la ligne équilibrée que nous proposons :
- Malgache comme langue de citoyenneté et d’accès aux droits (documents clairs, formulaires, plaquettes d’information), avec dispositifs d’accessibilité aux tenim-paritra quand c’est pertinent ;
- Français comme langue d’ouverture internationale (normes, recherche, coopération, arbitrages techniques).
Il ne s’agit ni d’un retour à une malgachisation autoritaire, ni d’une perpétuation d’un français excluant : il s’agit de construire un bilinguisme fonctionnel, au service de l’inclusion et de l’efficacité.
Le pays divisé en 18 ethnies, réuni par le français
Origine coloniale de la classification ethnique
- Colonisation française (1896-1960) :
Les autorités coloniales ont systématisé la division des populations malgaches en 18 groupes ethniques (Merina, Betsimisaraka, Sakalava, Betsileo, Antandroy, etc.).- Cette nomenclature a été renforcée par les recensements administratifs et scolaires, alors que dans la société précoloniale les identités étaient plus fluides et locales (clans, royaumes, lignages).
- L’objectif colonial était clair : appliquer le principe “diviser pour régner”.
- Source : Françoise Raison-Jourde, Les Souverains de Madagascar, Karthala, 1983.
Usage politique des divisions ethniques
- Sous la colonisation : les Français s’appuyaient sur les rivalités entre “côtiers” et “hauts plateaux” (Merina vs. autres groupes) pour éviter une unité nationale.
- Exemple : les Betsimisaraka de la « côte est » ont été utilisés comme contrepoids face aux Merina, héritiers de l’ancien royaume centralisé d’Antananarivo.
- Source : Solofo Randrianja, Sociétés et politique à Madagascar (XIXe-XXe siècles), Karthala, 2001.
- Après l’indépendance (1960) :
- Philibert Tsiranana (premier président, originaire du nord-ouest, Sakalava-Tsimihety) se présentait comme le porte-parole des “côtiers” contre l’hégémonie merina.
- Cette polarisation “côtiers vs. Merina” est restée un levier majeur dans les campagnes électorales (cf. élections 2001, 2018, 2023).
- Source : Jean Fremigacci, Madagascar, les années Tsiranana, Karthala, 2014.
Le rôle de la langue française comme ciment institutionnel
- Si le malagasy est la langue nationale (parlée sur toute l’île, avec variantes dialectales), ce n’est pas lui qui a été utilisé comme langue de l’État pour unifier.
- Les Français ont privilégié leur langue pour :
- L’administration,
- L’enseignement secondaire et supérieur,
- Le droit et la justice.
- Cela a fait du français la langue de cohésion institutionnelle dans un pays volontairement fragmenté par l’ethnicisation.
- Source : Jean-Pierre Raison, Les Hautes Terres de Madagascar et leurs confins occidentaux, ORSTOM, 1984.
Conséquences contemporaines
- Élections : la mobilisation électorale se fait encore sur des bases ethno-régionales. Exemple :
- Andry Rajoelina est perçu comme représentant les Hauts-Plateaux urbains (Merina/Antananarivo),
- Marc Ravalomanana, également Merina, mobilisait les Hauts-Plateaux agricoles,
- Hery Rajaonarimampianina ou Didier Ratsiraka cherchaient à s’ancrer côté “côtiers”.
- La rhétorique “côtiers vs. Merina” reste un ressort politique majeur.
- Source : Richard Marcus & Frédéric Martin, The Politics of Ethnicity in Madagascar, African Studies Review, 2004.
- Administration : malgré le discours officiel d’unité, les affectations de postes (gouverneurs, ministres, hauts fonctionnaires) sont scrutées sous l’angle ethnique pour évaluer l’équilibre.
- Identité nationale fragile : faute d’un récit unificateur solide basé sur le malagasy et sur une citoyenneté inclusive, l’ethnicité reste un marqueur politique latent.
Synthèse
- Les 18 ethnies sont une construction coloniale, consolidée par l’État malgache après 1960.
- Le français a servi de langue commune aux élites et à l’administration, jouant le rôle d’“unité artificielle”, mais en creusant la fracture avec le peuple malgachophone.
- Résultat : Madagascar reste marqué par un double héritage de division (ethnique) et de dépendance culturelle (français comme langue d’État), deux piliers de l’“indépendance inachevée”.
- Héritage historique : La colonisation a accentué les divisions internes en classifiant les populations (Betsimisaraka, Merina, Sakalava, etc.) pour mieux gouverner.
-
- Aujourd’hui : La langue malgache aurait pu unifier (elle existe avec ses variantes dialectales), mais c’est le français qui joue le rôle de « liant » administratif.
- Problème : Cela entretient une dépendance culturelle et linguistique à l’ex-colonisateur.
En résumé
Cette anthologie correspond exactement à ce qu’on appelle dans Diapason l’Indépendance inachevée. Madagascar a conquis la souveraineté formelle en 1960 (drapeau, hymne, siège à l’ONU), mais reste dépendant structurellement :
- Politiquement (élites connectées à Paris),
- Économiquement (secteurs clés dominés par l’étranger),
- Culturellement (langue, éducation),
- Socialement (fractures ethniques instrumentalisées).
Cela rejoint la notion de “65 ans après – L’architecture de la dépendance : une indépendance de façade qui masque un ancrage profond dans les mécanismes de domination économique et culturelle.
Ce que révèle cette radioscopie, c’est une évidence que beaucoup préfèrent taire : Madagascar n’est pas réellement indépendant. Les symboles sont là – un drapeau, un hymne, un siège à l’ONU – mais derrière, l’essentiel échappe encore à la maîtrise nationale.
Quand le président de la République est aussi citoyen français, quand les mines, l’énergie, les banques et les télécommunications sont dominées par des multinationales, quand la langue du droit n’est pas celle du peuple, quand les élites reproduisent les schémas coloniaux et quand la division ethnique reste un outil politique, alors il ne s’agit pas d’une coïncidence. C’est une architecture de dépendance savamment entretenue.
Dire les choses telles qu’elles sont n’est pas du défaitisme : c’est un acte de lucidité. Car il est impossible d’espérer un futur digne sans nommer les chaînes qui maintiennent encore Madagascar sous tutelle. Rompre avec ces dépendances est le seul horizon crédible.
L’enjeu n’est donc pas de célébrer une indépendance de façade, mais de construire enfin une souveraineté vécue. Une souveraineté qui ne se décrète pas dans les discours, mais qui se conquiert dans les faits – par la reprise du contrôle sur nos ressources, notre formation, nos institutions et notre récit collectif.
Soit Madagascar choisit de rester dans l’illusion, soit il assume de transformer son indépendance en réalité. L’histoire jugera notre courage.
Rédaction – Diapason
[1] https://www.diapason.mg/la-presidence-de-la-sadc-prestige-contre-pauvrete/
[2] https://www.diapason.mg/comprendre-la-situation-energetique-de-madagascar/
[3] https://www.diapason.mg/cartographie-economique-des-communautes-une-nation-des-visages/
[4] https://www.diapason.mg/madagascar-leconomie-fantome-dune-nation-spoliee/
[5] https://www.diapason.mg/liceberg-inverse-ce-que-le-monde-voit-ce-que-le-malgache-ignore/
[6] https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/cooperation-militaire-la-france-renforce-les-capacites-de-la-garde-presidentielle-malgache
[7] https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/fazsoi-entrainement-conjoint-du-batpara-malgache-2e-rpima
[8] https://mg.ambafrance.org/Formation-a-l-Ecole-superieure-de-la-gendarmerie-nationale-ESGN-de-MORAMANGA
[9] https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/-c%C3%A9r%C3%A9monie-de-cl%C3%B4ture-de-la-3%C3%A8me-promotion-des-cadets-de-la-gendarmerie-de-lesgn/1175864031248590/
[10] https://www.fondation-alliancefr.org/?p=58560
[11] https://www.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/madagascar-formation-commune-ensp-eniap-mai-2025-du-26-au-30-mai-2025-sest-d%C3%A9rou/1125754326259561/
[12] https://actu.orange.mg/deux-policiers-malgaches-senvolent-pour-une-formation-delite-en-france/
[13] https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/fazsoi-entrainement-conjoint-du-batpara-malgache-2e-rpima
[14] https://ecnl.org/sites/default/files/files/2021/MadagascarConstitution.pdf
[15]https://media.unesco.org/sites/default/files/webform/r2e002/6976583919a3e56e3e95d17e67a9fbcbebf83f38.pdf
[16] https://serge.bibauw.be/madagascar/sociolinguistique/
[17] https://serge.bibauw.be/madagascar/sociolinguistique/
[18] https://uprim-madagascar.mg/assets/uploads/2020/07/Le-francais-juridique-Extrait.pdf
[19] https://journals.openedition.org/cliothemis/1373
[20] https://www.francophonie.org/sites/default/files/2023-03/Rapport-La-langue-francaise-dans-le-monde_VF-2022.pdf
[21] https://patrinum.ch/record/16803/files/md_ms2_p26319_2014.pdf
[22] https://www.francophonie.org/sites/default/files/2022-03/Synthese_La_langue_francaise_dans_le_monde_2022.pdf
[23] https://www.constituteproject.org/constitution/Madagascar_2010
[24] https://serge.bibauw.be/madagascar/sociolinguistique/

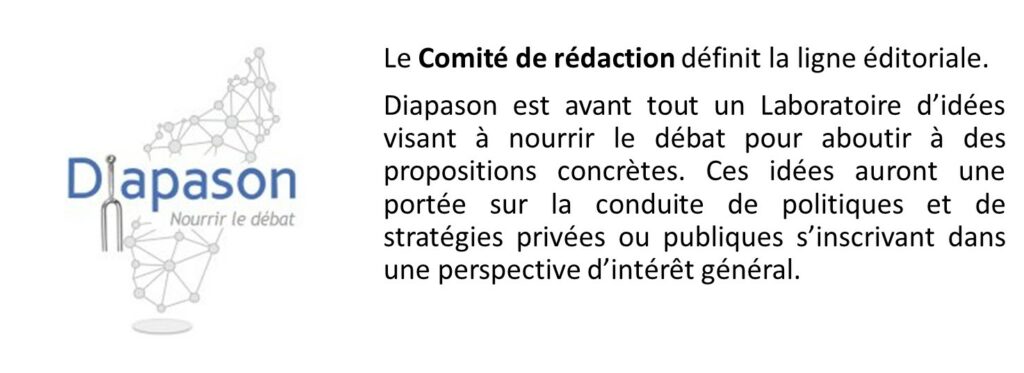
Je me permets de signaler une erreur. Dans le paragraphe Philibert Tsiranana vous mentionnez comme Source : Jean FREMIGACCI Madagascar , les années Tsiranana Karthala 2014.
Je ne trouve aucune trace de cet ouvrage. Est-ce le bon titre ? le bon auteur ? le bon éditeur ? la bonne année ?
Bonjour,
Merci pour votre commentaire.
Plusieurs travaux de Jean Frémigacci sur l’histoire politique de Madagascar et sur la période post-coloniale évoquent le rôle de Philibert Tsiranana et son inscription dans le prolongement des réseaux français.
Les bons ouvrages et nos sources sur ces sujets sont :
– Françoise Raison-Jourde (Les Souverains de Madagascar, 1983)
– Solofo Randrianja & Stephen Ellis (Madagascar : A Short History, 2009)
– Jean Fremigacci (La révolte de 1947 à Madagascar, Outre-Mers, 2007)
Cependant, la référence bibliographique énoncée est une erreur de concaténation. Encore merci pour votre concours.