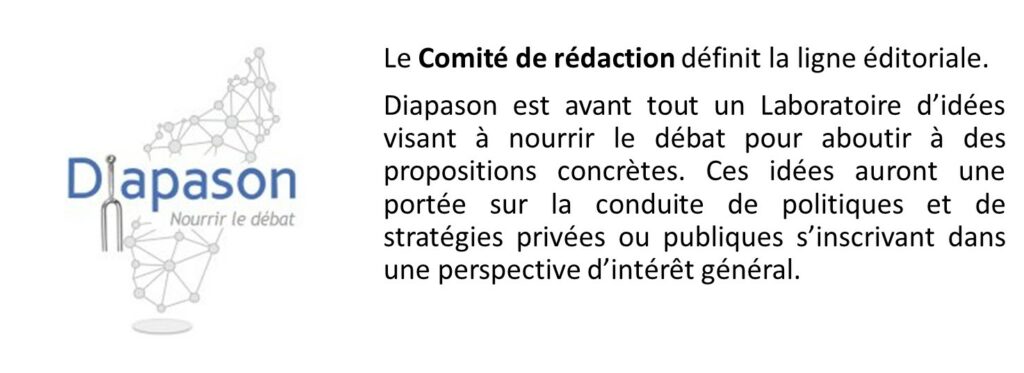Madagascar : Histoire de la construction d’une nation
Abstract
Retracer les chemins de l’histoire malgache : beaucoup se sont évertués à le faire, dans des styles variés, avec des méthodes différentes. Aujourd’hui, le besoin se fait sentir d’une publication d’accès facile, qui intègre les résultats des recherches les plus récentes. Tel est l’objectif de ce livre. A leur arrivée, les premiers occupants de la Grande Ile peuplent les côtes, et certains gagnent progressivement l’intérieur des terres.
Suit une phase de constructions politiques, au terme de laquelle l’une d’entre elles, animée d’un rêve unificateur, se fait reconnaître comme Royaume de Madagascar. Son échec, suivi du moment de la colonisation, n’entrave pas la détermination de la population. L’indépendance ouvre enfin la voie à un processus difficile et de longue haleine : la quête de la démocratie et du développement. L’ouvrage décrit ainsi la marche d’un peuple vers son unité.
Cette histoire retrace le parcours de Madagascar, dans sa continuité et ses ruptures. Elle relativise l’idée convenue d’une origine des Malgaches, au profit d’une intégration progressive dans l’océan Indien et d’une ouverture croissante sur le monde.
–§–
Article écrit
PAR JOHARY RAVALOSON
Lien : ♥