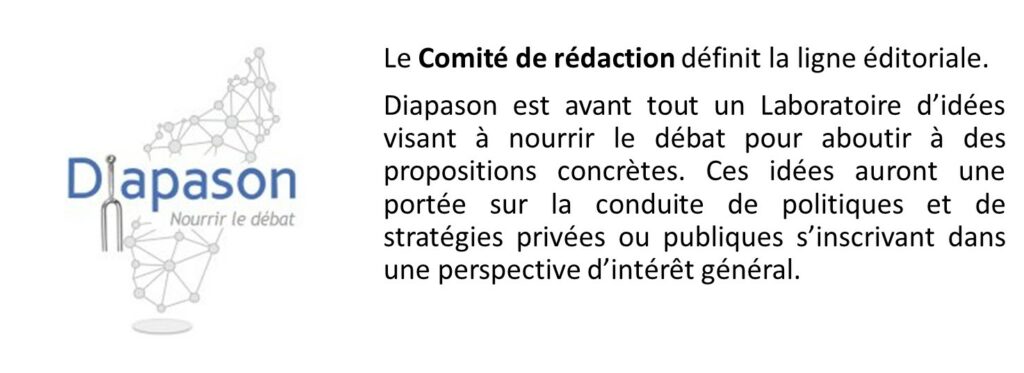La religion à Madagascar 1820-2020 (Dossier)
Abstract
Ce dossier retrace deux siècles d’histoire religieuse à Madagascar, depuis l’arrivée des missionnaires en 1820 jusqu’aux recompositions contemporaines. Il met en lumière la manière dont la religion a servi à la fois d’outil spirituel, de vecteur de pré-colonisation et de levier de contrôle social. L’étude analyse d’abord le socle spirituel autochtone – culte des ancêtres, hasina, sampy – avant d’examiner l’imposition du christianisme, la fusion entre évangélisation et colonisation, puis l’effacement progressif des repères traditionnels. La période coloniale a transformé l’éducation confessionnelle en instrument de formation d’auxiliaires pour l’administration et l’économie de plantation, renforçant la dépendance structurelle. Après l’indépendance, les Églises sont restées des acteurs majeurs de l’éducation, de la santé et de la médiation politique, jouant un rôle de contre-pouvoir mais aussi de palliatif à l’absence d’un État fort.
L’analyse comparative avec d’autres pays africains (Éthiopie, RDC, Mozambique, Botswana, Maurice, Comores) révèle que la variable déterminante n’est pas la religiosité en soi, mais la manière dont la religion est intégrée dans la culture nationale et articulée avec des institutions stables. Les pays pluralistes ou hybrides présentent des indicateurs de développement et de stabilité supérieurs, tandis que les pays fortement assimilés religieusement et colonisés restent fragiles. L’article conclut que le défi malgache consiste à transformer la religion, longtemps vecteur de domination, en levier de souveraineté et de développement, à travers une réappropriation de l’éducation, de la mémoire historique et de la connaissance.