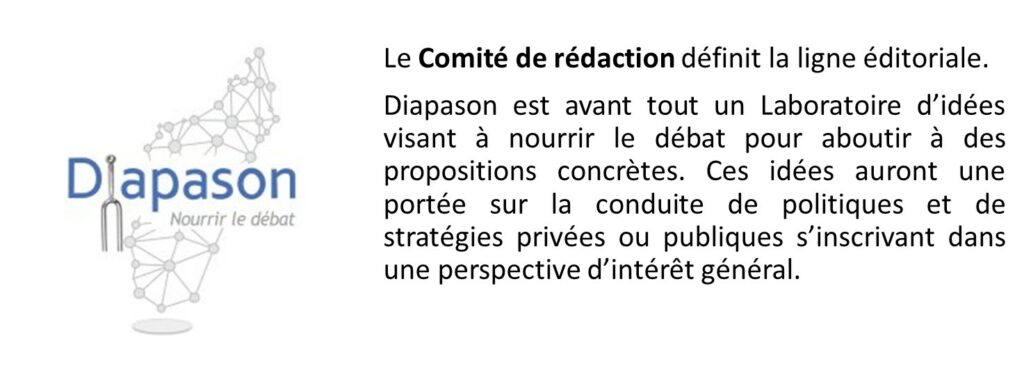Deux siècles après les missions, la religion structure toujours la société malgache
Date : 26/09/25
Introduction
Il y a, dans l’histoire des peuples, des fils invisibles qui continuent de tisser la trame de leur devenir bien après les ruptures visibles. À Madagascar, la religion fait partie de ces fils. Elle a accompagné les Malgaches depuis leurs premières structures sociales, nourries du culte des ancêtres et de la force du hasina, jusqu’à l’irruption, au XIXᵉ siècle, des missionnaires européens et de leur Dieu unique, en passant par la colonisation française, et jusqu’à l’époque actuelle où les Églises demeurent des acteurs centraux de la vie publique.
Comprendre la religion dans l’histoire malgache, c’est comprendre comment s’est jouée la bataille pour l’âme d’un peuple. Non pas seulement une bataille spirituelle, mais une bataille politique, sociale et économique. La religion fut, et reste encore, une manière d’organiser le pouvoir, de structurer la société et de donner un sens aux destins individuels et collectifs.
Or, à Madagascar comme ailleurs, la religion n’est pas seulement une affaire de croyances. Elle est aussi, et peut-être surtout, une technologie sociale de régulation. Elle permet de maintenir l’ordre, d’apaiser les tensions, d’assigner des places, de légitimer des hiérarchies. Lorsque les missionnaires arrivèrent sur l’île en 1820, ils ne vinrent pas seulement pour « sauver des âmes » : ils apportèrent avec eux une vision du monde qui allait transformer de fond en comble les structures symboliques, politiques et économiques du pays.
Aujourd’hui encore, Madagascar est l’un des pays les plus religieux du monde : selon les enquêtes du Pew Research Center (2018)[1], 95 % des Malgaches déclarent la religion comme « très importante » dans leur vie quotidienne. Mais derrière cette ferveur se cache un paradoxe : l’un des pays les plus croyants est aussi l’un des plus pauvres et des plus fragiles politiquement. La question n’est donc pas seulement de savoir si la religion est présente – elle l’est de manière massive – mais de comprendre comment elle s’articule aux institutions, à l’histoire et aux structures sociales.
Le socle spirituel autochtone : continuités et effacements
Avant 1820, Madagascar disposait d’un univers religieux cohérent et profondément enraciné. Zanahary – ou Andriamanitra chez les Merina – représentait le principe créateur, mais la médiation passait par les ancêtres (razana), dont la mémoire fondait l’ordre politique et social. Le hasina, force sacrée d’autorité et de prospérité, habitait souverains et objets rituels (sampy), perçus comme protecteurs des communautés.
Les pratiques reliaient le quotidien à l’invisible : sikidy (divination antémoro) pour guider les décisions, tromba (possession par les esprits des ancêtres), respect des fady (tabous) et rôle des mpimasy (guérisseurs) et mpikabary (orateurs).
Ce système assurait trois fonctions essentielles :
- Légitimer le pouvoir par le hasina et les sampy ;
- Réguler la vie sociale par tabous, bénédictions et malédictions ;
- Transmettre la culture par récits, proverbes et rituels.
Il liait les vivants aux ancêtres et garantissait la cohésion des royaumes. Mais l’arrivée des missionnaires bouleversa ce socle : ils imposèrent une nouvelle mémoire – l’écriture et la Bible – et un Dieu exclusif, au détriment des médiations autochtones.
L’imposition chrétienne : école, Bible et discipline sociale
Avec l’arrivée de la London Missionary Society en 1820, Madagascar entre dans une ère nouvelle. Les missionnaires n’apportent pas seulement un Dieu unique mais aussi des outils décisifs : l’école et l’écriture alphabétique latine (1822). En 1835, la Bible traduite en malgache devient le premier manuel de lecture. Apprendre à lire, c’est lire la Bible ; apprendre à écrire, c’est recopier les Écritures : catéchèse par l’alphabétisation.
Le savoir est désormais lié à la conversion : accéder à l’éducation suppose d’adopter la foi. Les sampy sont condamnés, le tromba stigmatisé, le culte des ancêtres relégué. L’éducation devient le vecteur principal d’une nouvelle cohérence symbolique.
Cette progression suscite des résistances, notamment sous Ranavalona I (1828-1861), qui persécute les convertis. Mais le mouvement s’impose : la conversion publique de Ranavalona II en 1869 consacre l’intégration du christianisme au cœur du royaume merina.
Derrière la foi, c’est une discipline sociale qui s’installe : obéissance, travail, hiérarchie. La morale chrétienne devient un outil de gouvernement des âmes, complément invisible du pouvoir politique. L’homme/la femme malgache est désormais façonné/e comme croyant discipliné et sujet loyal, modèle qui ouvrira la voie à l’entreprise coloniale.
Religion et colonisation : partenariat tacite pour dominer
Quand Madagascar devient colonie française en 1896, le terrain est déjà préparé. L’évangélisation a produit une élite alphabétisée, une morale de discipline et des institutions scolaires et paroissiales que l’État colonial va instrumentaliser.
Convergence des finalités. Les missions visent des croyants obéissants ; l’administration veut une main-d’œuvre docile et des auxiliaires fiables. Les premières forment et moralisaient, la seconde administre et exploite : un partenariat implicite mais efficace.
Ressources humaines. Les écoles missionnaires forment instituteurs, interprètes, commis, infirmiers et catéchistes. L’endoctrinement moral aligne devoir religieux et devoir civique : servir l’État colonial devient un prolongement de la foi.
Ressources naturelles. L’économie coloniale (café, vanille, forêts, mines) repose sur une main-d’œuvre encadrée. La patience et la pauvreté valorisées comme vertus chrétiennes réduisent les résistances. L’encadrement spirituel fragmente les révoltes, à l’exception de soulèvements comme les Menalamba (1895-1897), durement réprimés.
Ainsi, la religion ne participe pas directement à l’exploitation, mais elle en fournit le climat idéologique. L’ordre spirituel devient le meilleur allié de l’ordre colonial.
Dogme caché : soumission, culpabilité et résignation
L’un des effets les plus puissants de l’évangélisation à Madagascar n’a pas seulement été l’imposition d’un Dieu unique, mais l’intériorisation d’un dogme caché qui a façonné les comportements sociaux : celui de la soumission, de la culpabilité et de la résignation.
a) La soumission comme vertu
Dans le système précolonial, l’obéissance était négociée dans le cadre du fihavanana (solidarité et entraide communautaire), et la légitimité politique reposait sur le hasina. Avec le christianisme, l’obéissance devient une exigence divine. « Se soumettre » n’est plus seulement un acte social, mais une vertu religieuse. Obéir à l’autorité, qu’elle soit royale, coloniale ou religieuse, revient à obéir à Dieu lui-même.
b) La culpabilité intériorisée
La tradition malgache plaçait la faute dans la rupture des fady ou dans le non-respect des ancêtres, réparable par des rituels. Le christianisme introduit une nouvelle notion : la faute morale qui engage l’individu dans son for intérieur. La confession, la pénitence et le repentir deviennent des mécanismes d’intériorisation de la culpabilité. Cette mutation psychologique fragilise l’ancien équilibre communautaire en individualisant la faute et en inscrivant la culpabilité dans le cœur de chacun.
c) La résignation érigée en salut
La pauvreté, la souffrance, l’exploitation ne sont plus seulement des réalités sociales, mais des épreuves spirituelles. Endurer devient un signe de vertu, une manière de participer au sacrifice du Christ. Cette résignation, valorisée comme chemin vers le salut, contribue à limiter les révoltes et à renforcer l’acceptation de l’ordre établi.
d) Héritages persistants et caractère collectif
Aujourd’hui encore, cette intériorisation du dogme caché se retrouve dans les attitudes face à l’autorité et dans la difficulté à contester les inégalités. La religion a contribué à façonner une culture politique et sociale de la soumission, marquée par :
- Le respect presque sacralisé du pouvoir, même lorsqu’il est injuste ;
- L’évitement du conflit direct, considéré comme une faute ou un danger ;
- La tendance à « supporter » (miaritra) plutôt qu’à transformer l’ordre établi.
Au fil des générations, cette disposition est devenue bien plus qu’un héritage religieux : elle s’est cristallisée comme un trait de caractère emblématique du Malgache. Elle se traduit dans le langage courant (mora mora, « doucement »), dans la patience face aux crises, mais aussi dans la difficulté chronique à mobiliser collectivement pour changer les structures oppressives.
Autrement dit, la religion chrétienne, en légitimant la soumission et la résignation comme vertus, a façonné un ethos national où l’endurance et l’acceptation ont remplacé la contestation et la transformation. Ce trait, perçu parfois comme sagesse ou modération, est aussi l’un des freins les plus puissants à l’émancipation politique et économique de Madagascar.
Héritages et recompositions postcoloniales
L’indépendance de 1960 n’a pas réduit l’influence des Églises. Dans un État fragile, elles ont consolidé leurs positions.
Éducation. Environ 40 % des écoles primaires restent confessionnelles (UNICEF, 2019). Elles jouissent d’une réputation de sérieux, mais accentuent les inégalités, accessibles surtout aux classes urbaines.
Santé. Près de 20 % des structures de santé sont religieuses, souvent mieux équipées que le public rural. Leur efficacité repose toutefois sur des financements extérieurs (Caritas, ONG protestantes, réseaux évangéliques).
Solidarité et politique. Les paroisses demeurent des espaces communautaires. Surtout, le FFKM (1980) s’impose comme contre-pouvoir moral et arbitre politique, jouant un rôle décisif en 1991, 2002 et 2009.
Ambivalence. En remplaçant l’État défaillant, les Églises assurent des services mais maintiennent la dépendance. Leur conservatisme peut freiner des réformes sociétales. Elles sont devenues à la fois piliers de la société et rivales implicites de l’État dans certaines fonctions.
Comparaison internationale : quand pluralisme et enracinement changent la donne
La religiosité est élevée dans de nombreux pays africains : Madagascar (95 % « très importante »), Éthiopie (98 %), RDC (97 %). Mais la spécificité malgache réside dans son hybridité : 85 % chrétiens, avec 60 % de familles maintenant le culte des ancêtres.
Pluralisme. Madagascar reste peu diversifié (variantes chrétiennes + islam ~7 %). La RDC, massivement christianisée, a marginalisé ses traditions. À l’inverse, Maurice institutionnalise un pluralisme religieux (hindous 48 %, chrétiens 32 %, musulmans 17 %). L’Éthiopie conserve un équilibre historique entre orthodoxes, musulmans et protestants.
Poids institutionnel. Madagascar se distingue par un rôle fort des Églises : 40 % des écoles, 20 % des structures de santé, et un FFKM acteur politique. La RDC va plus loin (70 % des écoles, 40 % des soins), tandis qu’à Maurice et en Éthiopie, l’État conserve davantage la main.
Développement. Les pays « assimilés » religieusement (Madagascar, RDC, Mozambique) combinent forte religiosité, faible IDH et instabilité. L’Éthiopie garde une identité religieuse forte mais reste freinée par ses tensions internes. Les pluralistes ou hybrides (Maurice, Botswana) affichent les meilleurs indicateurs de gouvernance et de prospérité.
La variable clé n’est pas la religiosité, mais son articulation avec des institutions stables et un pluralisme assumé.
Conclusion : de la ferveur à la souveraineté
Deux siècles après les missions, la religion structure toujours la société malgache. Elle a offert écoles, hôpitaux, solidarité, et servi d’arbitre dans les crises. Mais elle a aussi naturalisé soumission et résignation, au point d’imprimer un ethos national qui freine la conflictualité nécessaire aux transformations structurelles. Le défi n’est donc pas de choisir entre « plus » ou « moins » de religion, mais de repenser son articulation avec la mémoire, l’école et l’État. Trois chantiers s’imposent :
- Réapproprier la mémoire. Reconnaître la valeur des traditions (ancêtres, hasina, fihavanana), en faire des ressources symboliques d’un récit national inclusif.
- Renforcer l’État. Passer d’un palliatif ecclésial à un État capable, assumant éducation, santé, justice – en partenariat, non en substitution.
- Réorienter l’éducation. De la docilité à l’esprit critique, la créativité, l’agir collectif.
Ce qui a jadis servi à dominer peut, demain, libérer : si la ferveur malgache devient énergie collective, reliée à des institutions solides et à un pluralisme assumé, elle portera une souveraineté véritable.
Mais l’enjeu est plus urgent encore. La trop forte docilité forgée par la religion et la colonisation a créé un caractère ambivalent : accepter l’inacceptable par passivité et inaction, tout en nourrissant une révolte intérieure non déclarée. Ce décalage rend la société vulnérable à des explosions soudaines, quand la pression accumulée dépasse le seuil supportable. Comme l’a montré l’histoire récente d’autres nations, du Népal ou ailleurs, l’absence de canaux structurés pour exprimer les tensions conduit tôt ou tard à une éruption. Madagascar ne pourra éviter ce destin qu’en transformant sa religiosité et son héritage en capacité de dire, d’agir et de construire collectivement.
La religion à Madagascar 1820-2020 (Dossier)
Sources
- Pew Research Center (2018). Global Religious Futures Project (religiosité, affiliations).
- UNESCO (2019). Statistiques mondiales de l’éducation (part des écoles confessionnelles).
- Transparency International (2022). Corruption Perceptions Index.
- Banque mondiale (2022). World Development Indicators (IDH, PIB/hab.).
- Noiret, F. (2009). Histoire des missions chrétiennes à Madagascar.
- Randrianja, S., & Ellis, S. (2009). Madagascar: A Short History.
Rédaction – Diapason
[1] https://www.pewresearch.org/topic/religion/religious-demographics/pew-templeton-global-religious-futures-project/