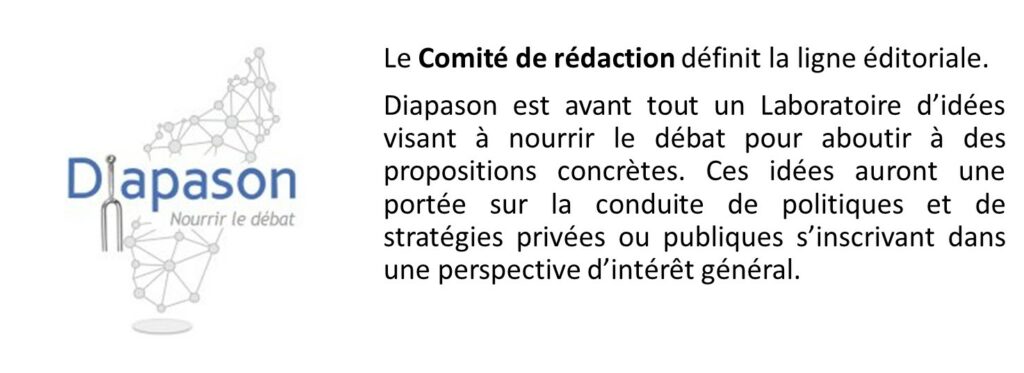Radioscopie d’un pays fragmenté : entre élites et peuple
Date : 12/09/25
Introduction
Madagascar a célébré en 2025 ses 65 années d’indépendance. Pourtant, au-delà des commémorations officielles, une question obsède : que signifie réellement ce mot dans la vie quotidienne des Malgaches ? Les symboles sont bien présents – un drapeau, un hymne, un siège à l’ONU – mais l’indépendance reste largement théorique. L’économie, l’éducation, la langue du pouvoir et les trajectoires présidentielles révèlent une souveraineté limitée, une illusion plus qu’une conquête.
Cette radioscopie propose une lecture anthropologique et critique des réalités malgaches, en se concentrant sur cinq dimensions : la nationalité et le parcours des présidents, le contrôle étranger des secteurs clés, la formation des élites administratives, le rôle du français comme langue dominante dans les hautes fonctions, et enfin la division du pays en ethnies. Ces cinq angles révèlent une architecture de fragmentation où l’élite francophone reste connectée à Paris et aux multinationales, tandis que la majorité vit en marge de l’État et de ses codes.
Nationalité et trajectoires des présidents malgaches
La trajectoire des présidents de Madagascar incarne à elle seule les ambiguïtés de la souveraineté. Le cas le plus emblématique est celui du Président Andry Rajoelina, naturalisé français en 2014 avec sa famille alors qu’il résidait dans l’Hexagone après la crise de 2009. Sa naturalisation française procède d’un décret publié au Journal officiel en novembre 2014 (décret du 19/11/2014, JO du 21/11/2014). Ce point n’est pas une “confirmation” par le Conseil d’État : juridiquement, la naturalisation est un acte réglementaire du gouvernement, susceptible de recours devant le juge administratif mais non “validé” par lui par défaut.
Lors de la présidentielle 2023, les recours de l’opposition n’ont pas porté sur la simple “double nationalité”, mais sur la perte alléguée de la nationalité malgache au titre de l’article 42 du Code de la nationalité (« Perd la nationalité malgache, le Malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère »). La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a, à différentes étapes, validé la liste des candidats et rejeté l’exception de nationalité dans ses décisions de proclamation. En clair : la contestation a bien visé la perte de nationalité, pas seulement la binationalité.
Cette situation reste inédite dans la période post-indépendance : non pas parce que des présidents n’auraient jamais été “français” (avant 1960, la nationalité française coloniale s’appliquait aux élites nées sous domination française, comme Tsiranana ou Ratsiraka, qui l’ont perdue en 1960), mais parce qu’un chef d’État post-1960 a volontairement acquis la nationalité de l’ancienne puissance coloniale et a ensuite exercé la magistrature suprême. Cela pose une question symbolique autant que juridique : à qui se rattache l’allégeance ultime, et que dit ce fait du rapport réel au principe de souveraineté ?
En miroir, les trajectoires de Philibert Tsiranana (études à Montpellier, réseaux de l’Union française), Albert Zafy (médecine en France), ou Marc Ravalomanana (dont l’ascension industrielle est liée avant tout à des partenaires nordiques/allemands, en particulier Tetra Pak – Suède, avec des stages en Suède et Danemark) illustrent la profondeur des liens académiques, économiques et culturels avec l’extérieur. Le problème n’est pas l’ouverture ; il est l’asymétrie et la dépendance qu’elle entretient.
Ces trajectoires montrent que le pouvoir malgache reste profondément connecté à la France, que ce soit par des filiations symboliques, des réseaux académiques ou des intérêts économiques. La conséquence est claire : la souveraineté politique demeure fragile, prisonnière de liens structurels hérités de l’histoire coloniale.
Les secteurs clés sont contrôlés par des entreprises étrangères
La dépendance se lit surtout dans la sphère économique. Tous les secteurs stratégiques sont dominés par des multinationales.
- Énergie. L’entreprise publique JIRAMA dépend structurellement de producteurs privés (IPP) et d’importations d’hydrocarbures. Sur le thermique, Jovena (groupe AXIAN) est adjudicataire fréquent des marchés de gasoil/fioul destinés aux centrales ; TotalEnergies, Vivo, Galana soumissionnent et remportent aussi des lots selon les années. Côté nouveaux projets, la filière hydroélectrique (ex. Volobe) agrège des capitaux et expertises étrangers. Le résultat est une vulnérabilité prix-volume qui se répercute sur les tarifs et sur la continuité de service. (Diapason, Comprendre la situation énergétique de Madagascar[1], 2025).
- Mines : Ambatovy, plus grand investissement étranger (8 milliards USD), est détenu par Sherritt (Canada), Sumitomo (Japon) et Korea Resources (Corée du Sud). QMM – Rio Tinto exploite l’ilménite à Fort-Dauphin, avec seulement 20 % de participation de l’État (Friends of the Earth, 2022). Base Toliara (Australie) reste suspendu après contestations sociales, tandis que le graphite attire des compagnies chinoises (Tirupati).
- Télécommunications : Orange (France) et Airtel (Inde) codominent avec AXIAN Telecom, qui a rebrandé Telma en “Yas” en 2024. AXIAN est un groupe basé à Madagascar, piloté par Hassanein Hiridjee (Malgache d’origine, nationalité française). Les infrastructures critiques (fibre, backbone, data centers) se jouent dans des montages capitalistiques régionaux et internationaux.
- Banques : BNI Madagascar est contrôlée par AXIAN (via IOFHL) avec un partenaire mauricien (IBL), BFV-SG – reprise par la Banque Populaire, en 2024 – était une filiale de la Société Générale, BOA dépend de BMCE (Maroc). (Banque centrale de Madagascar, Rapport 2023).
- Agro-industrie : la filière vanille est dominée par Symrise (Allemagne), Firmenich (Suisse) et McCormick (USA). Le clou de girofle et les huiles essentielles sont captés par des traders indiens et chinois. (Diapason, Cartographie économique des communautés[2], 2025).
Résultat : les richesses créées sur la Grande Île profitent surtout aux actionnaires étrangers. L’État détient rarement plus de 20 % des parts, et les conventions minières ou fiscales réduisent les retombées budgétaires. Comme le souligne L’iceberg inversé[3] (Diapason, 2025), Madagascar est riche mais les Malgaches vivent pauvres, car la rente nationale s’évapore vers l’extérieur.
Formation des hauts fonctionnaires en France
L’un des piliers de la dépendance est intellectuel. Après 1960, Madagascar a conservé l’architecture éducative héritée de la France. Les hauts fonctionnaires ont continué à être formés à l’ENA, à Sciences Po, à l’ENS ou dans les facultés françaises de droit, d’économie et de médecine. Cette reproduction a façonné une élite “francisée” qui pense et agit selon les codes français (Roubaud & Razafindrakoto, IRD, 2018).
En 2022, plus de 3 500 étudiants malgaches étaient inscrits dans des établissements français (Campus France, Chiffres clés 2022). La majorité se dirige vers le droit, l’économie, la science politique ou la médecine, autant de filières qui alimentent ensuite la haute fonction publique. Plusieurs ministres récents en témoignent : Richard Randriamandrato (Finances, Sciences Po Paris), Hajo Andrianainarivelo (Aménagement, études de droit en France), Rindra Rabarinirinarison (Économie, doctorat en France).
Les universités locales – Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliara – restent dépendantes de coopérations extérieures (IRD, CNRS, AUF). L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF, 2020) note que la recherche nationale est peu financée et rarement indépendante.
Conséquence : seuls ceux qui maîtrisent la langue et les codes français accèdent aux postes de pouvoir. L’État se reproduit dans un cercle fermé, accentuant la fracture avec la majorité malgachophone.
La langue officielle dans les hautes fonctions : le français
La langue est un autre révélateur de cette dépendance. Depuis la Constitution de 2010, le malgache et le français sont langues officielles. Entre 2007 et 2010, l’anglais avait été ajouté avant de disparaître. En théorie, le bilinguisme est garanti. En pratique, le français domine partout.
- Administration : lois, règlements, appels d’offres et notes techniques sont rédigés en français. (Constitute Project, 2010).
- Justice : la formation et la pratique du français juridique sont institutionnalisées (Programmes officiels, 2020). Historiquement, le droit colonial a imposé le français comme langue des juridictions (Marcus & Martin, 2004).
- Éducation : l’enseignement supérieur, notamment en droit, médecine et sciences politiques, est dispensé en français (AUF, 2020).
Ce choix linguistique a des implications politiques. Il crée un biais d’accès aux droits et aux services publics pour les citoyens non francophones, malgré le bilinguisme de droit. L’élite francophone contrôle les institutions, tandis que la majorité malgachophone est tenue à l’écart. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF, Rapport 2022) souligne le poids institutionnel du français dans le pays.
La fracture est double : linguistique et sociale. Comme l’a analysé L’économie fantôme d’une nation spoliée[1] (Diapason, 2025), la gouvernance dans une langue étrangère entretient une invisibilité démocratique.
Ceci dit, il nous faut préciser quelques points concernant la langue malgache.
Objection juste d’un lecteur : quel « malgache » ? Le malgache standard repose historiquement sur le dialecte merina (Antananarivo), alors que l’île compte de nombreux tenim-paritra (parlers régionaux). D’où la ligne équilibrée que nous proposons :
- Malgache comme langue de citoyenneté et d’accès aux droits (documents clairs, formulaires, plaquettes d’information), avec dispositifs d’accessibilité aux tenim-paritra quand c’est pertinent ;
- Français comme langue d’ouverture internationale (normes, recherche, coopération, arbitrages techniques).
Il ne s’agit ni d’un retour à une malgachisation autoritaire, ni d’une perpétuation d’un français excluant : il s’agit de construire un bilinguisme fonctionnel, au service de l’inclusion et de l’efficacité.
Le pays divisé en 18 ethnies, réuni par le français
La classification en 18 ethnies est une construction coloniale qui a rigidifié des identités plus fluides (clans, royaumes, lignages). La polarisation “côtiers vs hauts-plateaux” a été exploitée par l’administration coloniale, puis réinvestie dans la politique post-1960. Les nominations, les équilibres gouvernementaux, les mobilisations électorales sont encore lues à travers cette grille.
Dans ce contexte, le français a servi de ciment institutionnel pour une élite qui devait gérer la diversité : langue des textes, des contrats, des procédures. Mais ce ciment a eu un coût social : il a surplombé le malgache et ses parlers, nourrissant l’idée que l’accès au pouvoir passe par la maîtrise d’une langue importée. Le défi, aujourd’hui, est d’inverser la hiérarchie sans casser l’ouverture internationale.
Conclusion
Cette radioscopie met à nu une évidence : Madagascar reste un pays fragmenté où l’indépendance n’a pas été traduite en souveraineté réelle. Les présidents partagés entre deux nationalités, les secteurs stratégiques contrôlés par des capitaux étrangers, les hauts fonctionnaires formés en France, l’usage du français dans l’État et la division ethnique héritée de la colonisation dessinent les contours d’une dépendance persistante.
Rompre avec cette architecture ne signifie pas effacer l’histoire, mais choisir d’inventer un futur. Cela implique de reprendre la maîtrise des ressources, de renforcer les universités locales, et surtout de concilier intelligemment les langues de gouvernance : le malgache comme langue de citoyenneté et d’accès aux droits, et le français comme langue d’ouverture internationale et de coopération. L’enjeu n’est pas de substituer l’une à l’autre, mais de construire un bilinguisme fonctionnel qui unit au lieu de diviser, loin de la malgachisation autoritaire et destructrice imposée par le passé.
Il ne s’agit pas de célébrer une indépendance de façade, mais de construire une souveraineté vécue. La lucidité est la condition de la dignité : Madagascar ne pourra se projeter dans l’avenir que lorsqu’il aura reconnu et brisé les chaînes invisibles qui l’entravent encore.
Rédaction – Diapason
[1] https://www.diapason.mg/comprendre-la-situation-energetique-de-madagascar/
[2] https://www.diapason.mg/cartographie-economique-des-communautes-une-nation-des-visages/
[3] https://www.diapason.mg/liceberg-inverse-ce-que-le-monde-voit-ce-que-le-malgache-ignore/